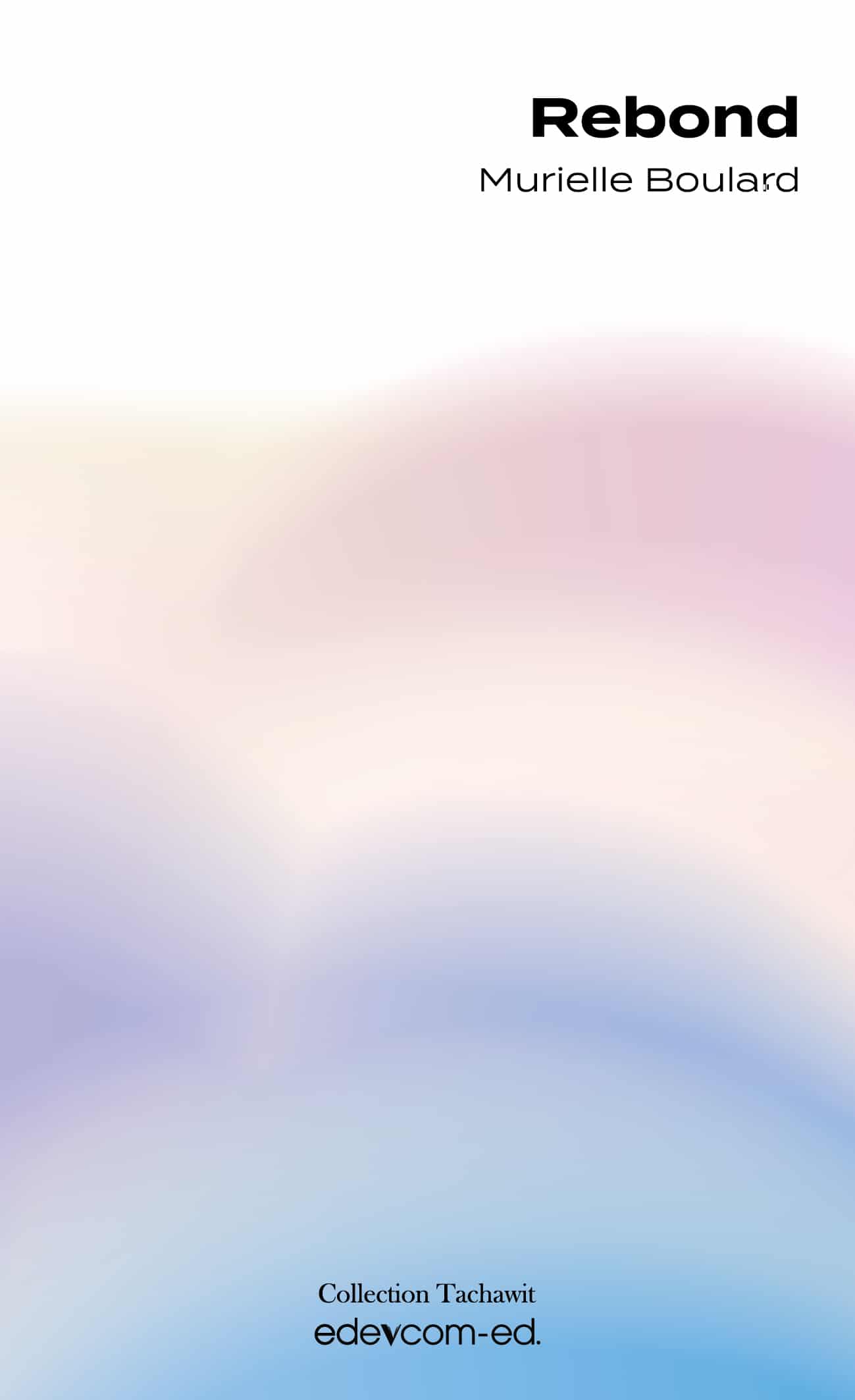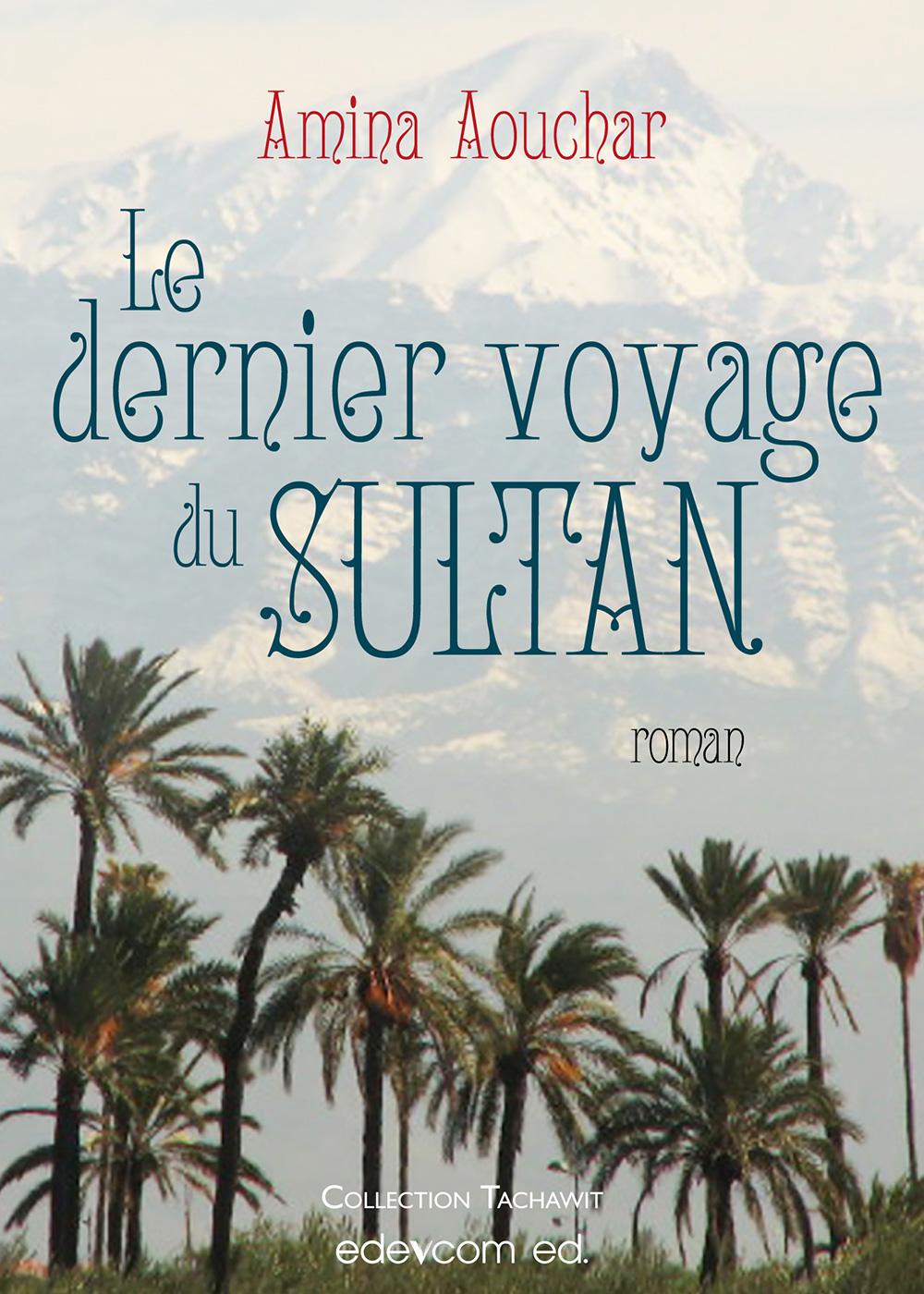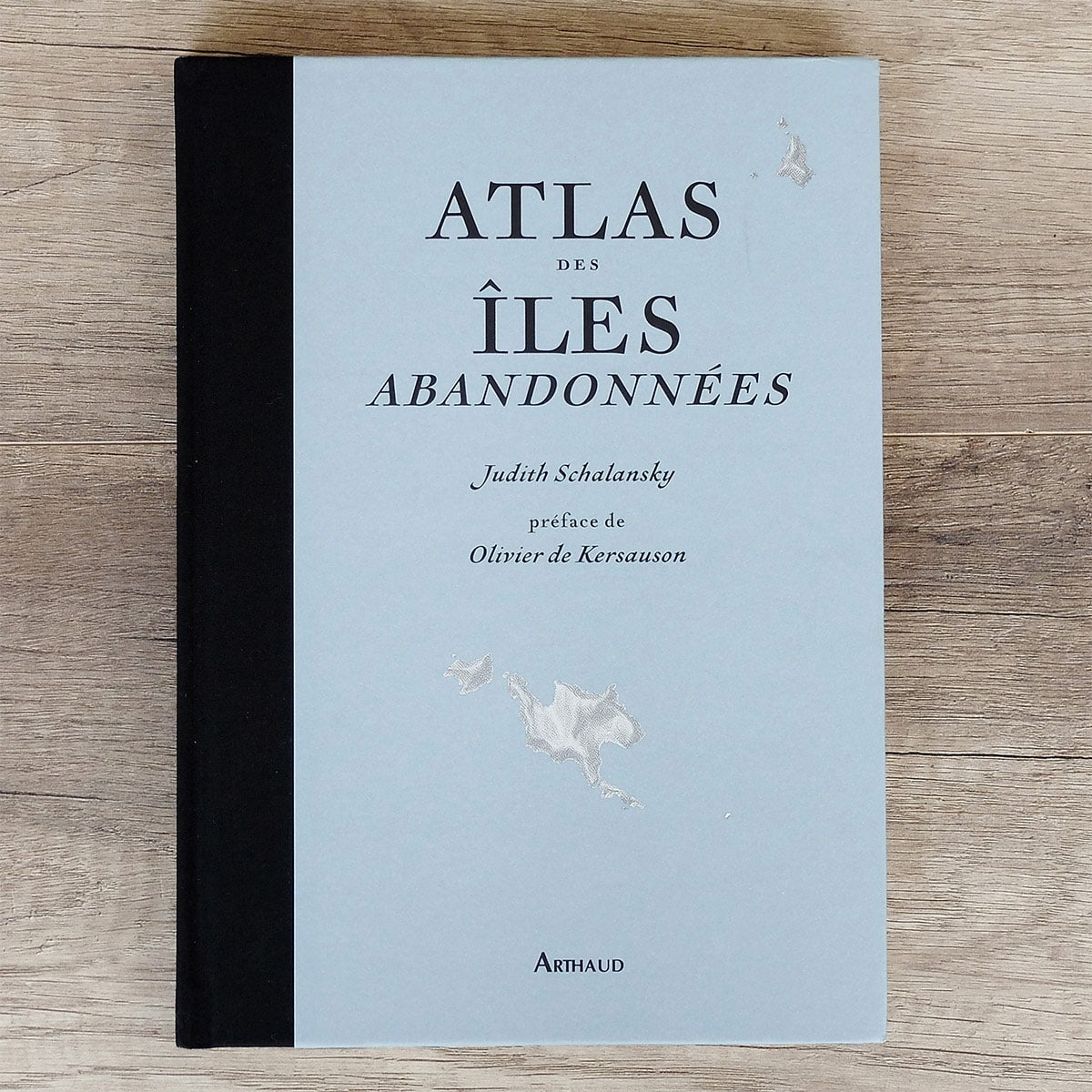L’art d’en faire le moins possible
Je crois que bien faire semblant de travailler c’est encore plus fatigant que de travailler vraiment. C’est une mécanique de précision, de l’horlogerie suisse. Il y a un timing à respecter, un groove. Il faut savoir quand accélérer, quand ralentir, quand interagir avec les collègues (surtout le faire à la fin des plages horaires classiques. A 11 h 50 ou 17 h 55. Le but c’est d’éviter d’avoir une réponse rapide. Un dossier qui traîne un peu, c’est l’assurance de ne pas en avoir un second à gérer tout de suite). Le tire-au-flanc doit être un tireur d’élite s’il veut survivre en terrain hostile, dans les décombres du Tertiaire.
J’avoue n’avoir aucun mérite particulier à déployer une stratégie d’esquive aussi élaborée. J’ai été à très bonne école. Durant mon premier stage en entreprise, mon responsable, Boris, était fantastique ! Un virtuose du pipeau, un esthète de l’esbroufe. L’imposture faite homme.
Pour mon premier jour de stage, le midi, il m’a invité au resto. Déjà le bonhomme a la classe, un grand prince !
Il a séché 2 pastis en apéro, puis il a tombé une bouteille de rouge au repas pour enfin se terminer avec deux limoncellos en digeo. Le mec encaisse. Et il a beau s’arroser, il ne se noie jamais. Il doit avoir une prothèse de foie en titane, c’est pas possible !
Quand les cafés arrivent, il me dévisage et me lance goguenard : « Dis donc minot, sérieusement, t’as vraiment envie de faire carrière dans ce genre de boîte ? » Même si l’ambiance s’y prêtait plutôt, je n’ai pas eu envie d’être très honnête. Sait-on jamais, ça pouvait très bien être un guet-apens ! Ne jamais baisser la garde trop tôt, on n’est jamais à l’abri d’un uppercut soudain.
J’ai donc répondu par une pirouette que j’avais préparée pour ce genre d’occasion : « Oui, je suis jeune mais ambitieux et j’adore travailler en équipe. Cette boîte, c’est le cadre parfait pour moi, pour apprendre mais aussi pour mettre en application mes compétences. J’espère que ça sera un winwin deal. Cette boîte peut m’apporter beaucoup, mais je crois aussi que je peux lui apporter beaucoup. J’ai la faiblesse de croire que la valeur n’attend pas le nombre des années ».
Il m’a regardé avec les yeux qui brillent (probablement le limoncello qui faisait doucement effet) et m’a balancé :
– Très bien, très bonne réponse. C’est creux, ça n’a aucun intérêt mais ça sonne bien. On dirait du R’N’B. T’as le flow, mais va falloir apprendre à t’en servir si tu veux passer une carrière sous le parasol, le cul posé sur la glacière à voir les autres vendre des esquimaux en plein cagnard.
– Ah mais non ! Moi, j’ai besoin de me sentir utile, d’aimer ce que je fais, de savoir pourquoi je me lève le matin.
– OK, très bien. Grand bien te fasse. Si besoin, tu sais ou me trouver.
Le repas s’était achevé comme ça, dans une ambiance un peu étrange. Je ne savais pas trop quoi penser de ce responsable de stage qui proposait de m’apprendre à tirer au flanc. C’était un peu surréaliste.
Une semaine de stage plus tard, je me souviens être allé frapper à la porte de Boris :
– Salut Boris, je peux te déranger 5 minutes ?
– Oui vas-y ! Qu’est ce qui se passe minot ?
– Bon, alors c’est quoi ton histoire de parasol, glacière et tout ça… ?
– Haha ! Ça y est ! T’y es arrivé ? T’as quand même tenu une semaine, c’est pas mal ! Je te félicite.
– Ouais, mais j’ai failli mourir d’ennui. Je savais pas que c’était si affreux le travail. C’est encore pire que les études ! J’aurais jamais cru que c’était possible.
– Bah, c’est exactement ça. Il faut savoir que le travail, c’est pas l’aboutissement des études mais la continuité. Les études chiantes débouchent sur des boulots chiants. C’est ça la règle. Y a pas de miracle. Si tu t’es emmerdé à la fac, tu t’emmerderas au bureau. Tu t’es emmerdé à la fac ?
– Tu veux dire en dehors des soirées et des heures de cours séchées pour aller jouer au foot ou faire de la musique ? Oui, profondément ! Faut dire que le droit, c’est plus une discipline de devoir que de passion.
– On est bien d’accord. Du coup, le seul intérêt du boulot, c’est la fin du mois. Il faut donc tromper l’ennui sans que personne ne s’en rende compte pendant vingt-neuf jours pour mériter le trentième. Par contre, il est indispensable d’avoir une passion, à tout le moins une occupation, discrète sinon tu risques de mourir à l’intérieur. On ne peut pas occuper vingt-neuf jours en se contentant d’aller de sites d’infos en sites de sport, de Facebook en Gmail. Sinon, en deux jours à peine, tu te fais sauter le couvercle. Moi j’ai une passion, qui pourrait me valoir quelques invitations à des dîners de cons. Je suis concepteur de jeux de société.
– Bah, moi, j’aime bien écrire.
– Parfait ! C’est bien ça, c’est discret, silencieux. Alors ouvre bien tes esgourdes, ceci te servira à devenir écrivain au frais de la boîte. Il te faut :
- Marquer le territoire. Comme tout mammifère, quand tu arrives dans un nouvel endroit, n’hésites pas à faire pipi dans les coins, à faire en sorte qu’on sache que tu es là. Il est impératif que tu sois non pas identifié par un petit nombre de collègues mais identifiable par leur grande majorité. Quelques fulgurances de ta part, surtout au début, seraient les bienvenues. En fait, il faut que tu sois reconnu comme le gars qui a… Je précise que la suite de cette phrase doit être méliorative hein… Boucher les chiottes n’est pas une option.
- Être un personnage secondaire de la vie de l’entreprise. Pas un personnage principal (c’est à eux qu’on demande le plus d’investissement au quotidien. Du coup quand ils baltringuent, ça se voit, direct), ni un figurant (ce sont les premiers qu’on lourde, ceux qui n’ont pas droit à l’erreur, ceux qu’on surveille le plus). Il faut trouver l’équilibre, et dans équilibre il y a libre ne l’oublie jamais !
- Complexifier ton métier à outrance. Ne jamais dire que ce que tu fais est simple, même si tu vas juste recopier un texte de trente-deux caractères. Ne jamais répondre « oui » à une demande, même simple, mais « je vais essayer », « je fais au mieux », « je vais voir ce que je peux faire ». Comme ça, tu pourras mettre quatre heures à faire un truc qui te prend vingt minutes (te libérant ainsi trois heures et quarante minutes pour écrire) sans que personne n’y trouve à redire. Ne jamais simplifier le langage pour que les autres comprennent, au contraire. Pense bien jargon ! Si c’est du droit, n’hésite pas à mélanger le latin et l’anglais. Moins les gens comprennent ce que tu fais, mieux tu te portes.
- Ne pas hésiter à squatter à intervalles réguliers les espaces communs (et encore une fois pas les chiottes). Les allers-retours entre ces espaces et ton bureau donnent l’illusion du mouvement, de la création de la valeur ajoutée. Si c’est nécessaire, n’hésite pas à imprimer des trucs sans intérêt pour aller les chercher à la photocopieuse. Une fois récupérés, lis-les en marchant en revenant à ton bureau. Les gens doivent croire que tu fissures l’atome pour que tu puisses tranquillement fissurer le tome.
- Organiser l’anarchie sur ton Il faut que quand on y rentre, on pense que tu es frappé de méningite sans jamais soupçonner la mouche Tsé Tsé. Il faut que ça ressemble à un laboratoire, à un volcan avec du savoir en fusion. N’hésite pas à ne jamais jeter tes brouillons et à les laisser prospérer sur ton bureau IKEA. Griffonne des trucs au stylo sur des feuilles volantes. En 2019, ça fait élite, mec qui se donne du mal.
- Toujours rester évasif sur ta vie privée. L’idée c’est de demeurer un sujet, et non un objet, de discussions. Préserver le mystère. Arrivés un âge, les gens normaux (Bac – fac – rencontre d’une fille – diplôme – début de carrière – mariage – bébés – Renault Scenic – pavillon de banlieue – prise de poids – footing le dimanche en jogging Intersport – ménopause/ Assurance vie – assurance obsèques – retraite – pétanque) adorent baver sur les collègues, et particulièrement savoir ce qu’il y a au fond de leurs slips et ce qu’ils en font. Ne pas donner de détail, c’est l’assurance de voir ces commères épaissir ton personnage : « C’est bizarre qu’il soit célibataire encore à son âge ! », « tu crois qu’il est homo ? », « ça a l’air d’être un écorché vif, il a les pupilles tristes », « je suis sûr que ça a été un enfant battu, je le sens ! » Attention c’est la suite qui est intéressante : « Ça se voit qu’il se noie dans le boulot pour oublier quelque chose de triste ! ». Bingo ! Les mecs qui rament sur la galère, dans la cale, te demandent à toi qui es, officieusement sur le pont à contempler l’horizon, si tu veux pas un verre d’eau.
- Ne pas être avare de petites attentions. Les liens familiaux sont comme les ligaments, le temps les distend. Les gens ont tous des souvenirs d’une grand-mère, d’un oncle, qui fêtait comme il se doit Noël, Pâques, les Rois… À toi d’apporter de temps en temps une boîte de madeleine de Proust. Tu fais des cadeaux à 1 euro sur Amazon à une bonne partie du bureau (ceux avec lesquels tu interagis) pour Noël, tu ramènes une galette des Rois à l’Épiphanie, des gâteaux pour la fin du Ramadan (tous les râteliers sont bons à recevoir mes chiens de fusils) et te voilà perçu comme un élément fédérateur, le ciment d’une équipe (et dans ciment, il y a ment).
- Doser ton cynisme. Il faut faire preuve d’intelligence sociale. Avec la hiérarchie, c’est deux tiers de pipeau, un tiers de chiffres. Avec les collègues, c’est deux-tiers de « s’il te plaît » et un tiers de « t’en fais pas, je m’en occupe ».
- Écrire de longs mails chiants à mourir et les finir par « disponible pour en discuter ». Personne ne voudra jamais le faire mais tu as proposé et c’est ce que les gens retiendront.
- Dire « nous » quand tu parles de la boîte. Ça fait corporate, investi.
Voilà, ça te fait dix commandements à suivre. Avec ça tu devrais être peinard pour écrire ton bouquin.
J’ai scrupuleusement suivi les conseils de Boris. Force est de constater que ça marche…
Chapitre 15, p.87 et suivantes