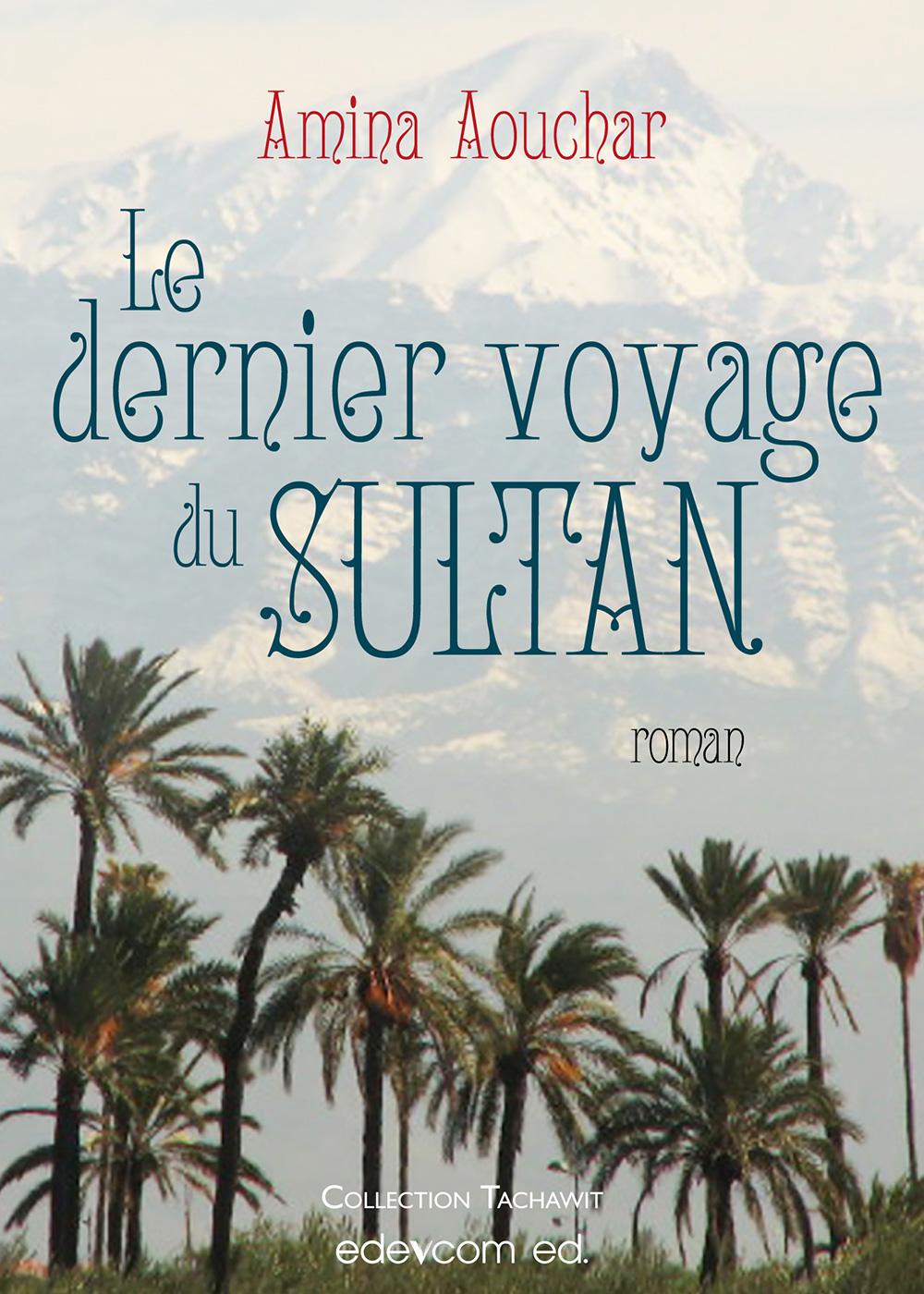Leila Slimani : Le pays des autres
Roman, Paris, Gallimard, 2020, 365 p.
1 re partie, La guerre, la guerre, la guerre
C’est un tableau du Maroc des années cinquante d’une grande justesse que nous offre là Leila Slimani. Certes, selon son propre témoignage, l’auteur a fait appel aux œuvres et aux récits d’historiens marocains de renom. Mais la psychologie des personnages et l’art de présenter leur situation dans une période aussi troublée, relèvent du talent de l’auteur.
Un marocain, Amine, combattant pendant la Seconde Guerre mondiale, se marie avant de rentrer au pays avec Mathilde, une jeune alsacienne. Féru de botanique et ayant foi dans le progrès, il s’installe en 1947 avec son épouse dans la région de Meknès où il souhaite exploiter une petite ferme rocailleuse héritée de son père. La mise en valeur de cette propriété exigera de durs travaux et le couple connaîtra avec ses deux enfants, l’inconfort, la solitude et la pauvreté.
Ce couple maroco-français, malgré l’amour qui lie les époux, est confronté aux difficultés dues à la juxtaposition de deux cultures, dans un contexte où colonisés et colonisateurs s’affrontent avant l’accession du Maroc à l’indépendance. Alors que le pays est en effervescence, Amine et Mathilde n’écoutent pas la radio, ne lisent pas les journaux et pensent pouvoir rester à l’écart de cette confrontation… Jusqu’au moment où les fermes des colons des alentours sont incendiées et qu’ils en arrivent même à craindre pour leurs vies.
Amine a épousé Mathilde par amour ; il apprécie notamment son courage et son appétit de vivre. Mais ses sentiments sont ambivalents. D’avoir une épouse française lui donne, d’une part, le sentiment d’être « moderne », supérieur à ses concitoyens. D’autre part il lui semblait que « Mathilde faisait de lui un traître et un hystérique » (p. 112). Parfois, il aurait voulu « une femme pareille à sa mère qui ait la patience et l’abnégation de son peuple qui travaille beaucoup et parle peu ». Il aurait voulu une épouse plus soumise qui sache adapter son comportement aux usages de sa famille et de ses amis qui sache élever leurs deux enfants, surtout le garçon, selon les coutumes marocaines.
Mathilde fait de réels efforts pour s’adapter à sa belle-famille, aux traditions locales et apprend le marocain. Elle se montre attentive à sa jeune belle-sœur qu’elle voudrait voir plus assidue à l’école et à sa belle-mère qu’elle prend en charge lorsque la santé de la vieille femme se détériore ; mais « son statut d’étrangère la maintenait à l’écart du cœur des choses ».
Elle a épousé Amine par amour, et même par passion charnelle. Elle est fière de son acharnement au travail, de ses connaissances en matière agricole, etc. Mais elle ne comprend pas qu’il ait tant changé après leur installation au Maroc. L’officier si romantique qu’elle a connu en 1944 quand il était en garnison à Mulhouse, est devenu un homme taiseux, austère qui lui impose une vie étriquée et fruste. Elle est irritée par ses prétentions à l’éduquer : « ici, c’est comme ça… Ça ne se fait pas… On n’a pas les moyens… », lui répète-t-il. Elle n’accepte pas qu’il baisse la tête devant le commerçant ou l’employé de bureau qui le tutoie et le méprise… et qui ne s’excuse que quand il voit les médailles militaires accrochées à la veste de son mari.
Les enfants du couple souffrent aussi de la situation complexe de leurs parents. Aïcha inscrite dans une école tenue par des religieuses catholiques, est troublée par sa double culture. Considérée comme une « indigène » par ses camarades européennes qui la méprisent, ignorée aussi par ses riches camarades marocaines, ignorante des traditions religieuses de son père, Aïcha ne trouve un peu de chaleur humaine qu’auprès d’une bonne sœur.
Les relations sociales dans le contexte colonial sont exposées dans toute leur complexité : arrogance d’une bonne partie des colons, des commerçants et fonctionnaires français qui manifestent leur mépris à l’égard des autochtones à qui il est interdit de prendre les ascenseurs, de s’installer dans des cafés pour Européens, de prendre le train en 1 re classe, etc.. La colonie française méprise aussi les Européens pauvres, ou les apatrides ou ceux qui « fraternisent » avec les Marocains. Ceux-ci sont voués à vivre en médina, la ville « indigène », sale et humide et ne sont pas les bienvenus dans « la ville nouvelle » avec ses cinémas, ses beaux cafés, ses boutiques de luxe. Mathilde elle-même, si ouverte, si libre, interdit à sa bonne de partager ses toilettes. Pourtant elle ouvre un dispensaire à la ferme et y soigne les miséreux des environs qu’elle traite avec beaucoup de compassion.
Ce que ce livre montre aussi avec beaucoup de justesse c’est le sort des femmes, autochtones mais aussi françaises de France et du Maroc. Toutes, même si elles n’en ont pas conscience, sont soumises à leurs maris ou à leurs frères qui peuvent les battre, les priver, les exploiter.
Mais elles ne se sentent pas solidaires à cause de leurs différences de nationalité, de religion, de richesse.
Un livre juste, au style plus classique que les œuvres précédentes de l’auteur, qui donne envie de lire la suite.